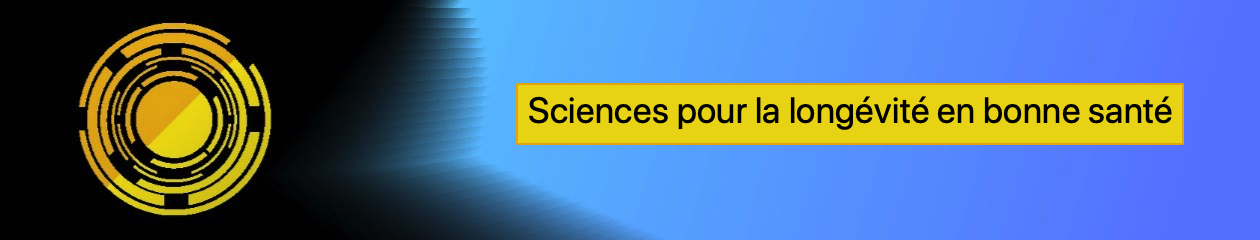Le désir d’échapper à la condition humaine, je le soupçonne, sous-tend également l’espoir de prolonger la durée de vie de l’homme bien au-delà de la limite de cent ans. Hannah Arendt, philosophe. La condition humaine, 1958 (source).
Le thème de ce mois-ci : Tardigrades
Les tardigrades, également connus sous le nom d’ours d’eau, sont des invertébrés microscopiques mesurant entre 0,1 et 1 mm de long et possédant 8 pattes. Découverts en 1773, ils vivent dans des environnements très divers, notamment dans les océans, les eaux douces et les écosystèmes terrestres tels que les mousses, les lichens et le sol. À ce jour, 1380 espèces de tardigrades vivants ont été recensées dans le monde. Malgré leur petite taille, les tardigrades jouent un rôle écologique important dans le cycle des nutriments et la régulation microbienne au sein de leurs habitats.
Les tardigrades sont surtout connus pour leurs extraordinaires capacités de survie : Ils ont survécu à plusieurs extinctions massives, ont volé en orbite et se sont posés sur la Lune. Ils peuvent survivre 20 mois congelés à -200°C , à d’immenses pressions, au vide spatial et à des substances toxiques. Certaines espèces (du genre Paramacrobiotus par exemple) sont 1000 fois plus résistantes aux rayons UV et X que l’homme et peuvent même survivre sans oxygène pendant plusieurs jours. Leurs adaptations physiologiques uniques en font un sujet d’intérêt pour la recherche scientifique, notamment en astrobiologie, en génétique et en études environnementales.
Comment font-ils pour survivre à tout ?
Les tardigrades doivent leur extrême résilience à plusieurs adaptations biologiques. L’une de leurs principales stratégies de survie est la cryptobiose, un état dans lequel ils arrêtent presque complètement leur métabolisme en réponse à des conditions environnementales extrêmes. Dans cet état, les tardigrades perdent 99 % de leur eau corporelle et se recroquevillent sous une forme desséchée appelée tun, ce qui leur permet de survivre à une déshydratation extrême (anhydrobiose), à des températures glaciales (cryobiose), à une salinité élevée (osmobiose) et à un manque d’oxygène (anoxybiose). Par exemple, dans une étude réalisée en 2016, des chercheurs japonais ont réussi à récupérer et à reproduire un tardigrade antarctique provenant d’un échantillon de mousse congelé depuis plus de 30 ans.
Un facteur clé de leur survie est la production de protéines bioprotectrices, connues sous le nom de Tardigrade-Specific Intrinsically Disordered Proteins (TDPs). Ces protéines remplacent l’eau à l’intérieur de leurs cellules et forment une structure protectrice en forme de gel qui empêche les dommages causés aux molécules biologiques sensibles, telles que l’ADN et les protéines. Lorsque les conditions redeviennent favorables, les tardigrades peuvent se réhydrater et reprendre une activité normale en quelques heures.
Les tardigrades possèdent également des mécanismes de réparation de l’ADN très efficaces qui leur permettent de survivre à des niveaux élevés de radiation, qui provoqueraient généralement des mutations mortelles chez d’autres organismes. En outre, certaines espèces produisent des pigments qui agissent comme un bouclier contre les rayons ultraviolets nocifs.
Ces adaptations remarquables font des tardigrades l’une des formes de vie les plus résistantes sur Terre. Leur capacité à survivre dans l’espace a suscité un grand intérêt scientifique, notamment dans les domaines de l’astrobiologie et de la biotechnologie, où les chercheurs étudient leurs mécanismes de survie uniques en vue d’applications potentielles en médecine, dans la conservation des aliments et dans l’exploration spatiale.
Application pour la science et la longévité
La protéine Tardigrade Damage Suppressor Protein (Dsup) a donc été identifiée comme un facteur clé dans la capacité du tardigrade à protéger son ADN des dommages causés par des facteurs de stress tels que les radiations et la déshydratation. La recherche a montré que lorsque la Dsup est introduite dans des cellules humaines, elle aide à réguler les gènes impliqués dans la réparation et la transcription de l’ADN. Une étude a montré que l’expression de Dsup augmentait les niveaux d’antioxydants et restaurait les paramètres clés altérés par l’exposition aux UV, tels que la longueur du tube pollinique, la position de l’unité germinale mâle et l’expression des protéines de stress (tubuline, HSP70). Ces résultats suggèrent que Dsup pourrait renforcer la résistance du pollen aux UV-B et améliorer la tolérance des plantes aux radiations solaires. Cette protéine pourrait jouer un rôle vital dans la protection de l’ADN humain contre les dommages environnementaux et pourrait avoir des applications thérapeutiques dans le traitement du cancer, où les mécanismes de réparation de l’ADN sont cruciaux pour l’efficacité des thérapies. La chimiothérapie et la radiothérapie provoquent souvent des lésions de l’ADN dans les cellules saines, ce qui limite leur succès et entraîne des effets secondaires néfastes. En appliquant des protéines ou des gènes dérivés de tardigrades à des cellules humaines, les chercheurs pourraient potentiellement améliorer la capacité des cellules à réparer l’ADN, ce qui les rendrait plus résistantes aux effets néfastes des thérapies anticancéreuses. Cela pourrait contribuer à accroître l’efficacité des traitements tout en minimisant les dommages causés aux tissus sains.
La cryoconservation, qui consiste à conserver des cellules, des tissus ou des organes à basse température, est un autre domaine dans lequel la recherche sur les tardigrades a des applications. Les tardigrades sont capables de survivre à une dessiccation extrême, un processus similaire à la cryoconservation. En étudiant les gènes responsables de leur résistance au stress, les chercheurs travaillent à l’amélioration des techniques de cryoconservation des cellules, tissus et organes humains, ce qui pourrait révolutionner la transplantation d’organes et la préservation du matériel génétique.
En tant qu’organismes extrêmophiles, les tardigrades peuvent survivre dans l’espace. En 1964, il a été suggéré pour la première fois que les tardigrades pourraient servir d’organismes modèles pour la recherche spatiale en raison de leur extraordinaire résistance aux radiations. Au fil des ans, des études sur leur cryptobiose ont révélé une résistance encore plus grande, en particulier dans les conditions spatiales. Plusieurs missions, telles que FOTON-M3 en 2007 et la mission Endeavour en 2011, ont permis d’étudier comment les tardigrades survivaient aux facteurs de stress de l’espace, tels que la microgravité et les radiations. La dernière recherche spatiale impliquant des tardigrades a été le Phobos Life Project, qui visait à tester la survie d’organismes au cours d’un vol interplanétaire, à l’appui de la théorie de la panspermie. Malheureusement, la mission s’est soldée par un échec lorsque le vaisseau spatial s’est écrasé en 2012.
En outre, cet organisme a fait preuve d’une remarquable résilience face à des pressions extrêmes soutenues, supportant jusqu’à 74 000 atmosphères, ce qui équivaut à une descente de 180 km vers le noyau de la Terre. Cette pression est supérieure à celle nécessaire à la formation des diamants. Malgré ces conditions intenses, la structure et l’intégrité de leurs cellules restent inchangées.
La capacité des tardigrades à entrer en cryptobiose les rend non seulement aptes à survivre à de longs voyages cosmiques, mais ouvre également la possibilité d’explorer s’ils pourraient survivre et prospérer sur d’autres planètes.
Une autre possibilité d’utiliser les tardigrades comme modèle pourrait être d’étudier comment ils vieillissent lorsqu’ils entrent en cryptobiose. L’hypothèse de la « belle au bois dormant » suggère que les tardigrades ne vieillissent pas pendant cet état de sécheresse, même si elle n’a pas été entièrement explorée. Cette hypothèse a récemment été testée en soumettant un groupe de tardigrades à des périodes alternées de congélation à -30°C et d’alimentation à 20°C. Les résultats ont montré que les tardigrades congelés vivaient deux fois plus longtemps que le groupe témoin. Cette étude représente la première preuve expérimentale que les tardigrades réduisent leur vieillissement pendant la cryobiose.
Les Tardigrades ne sont pas les seuls à pratiquer la cryptobiose
Comme les tardigrades, certains rotifères bdelloïdes peuvent entrer en cryptobiose pour survivre à des conditions extrêmes, y compris une congélation prolongée. Une étude publiée en 2021 a révélé qu’un rotifère bdelloïde du genre Adineta, extrait du pergélisol sibérien et daté au radiocarbone d’environ 24 000 ans avant notre ère, a été réanimé avec succès. L’analyse génétique a confirmé sa classification et démontré qu’il pouvait se reproduire par parthénogenèse en laboratoire. Cette découverte représente le plus long cas documenté de survie à l’état congelé pour un organisme multicellulaire, mettant en évidence la cryptobiose comme une stratégie biologique remarquable qui permet à certaines formes de vie de résister à des environnements extrêmes et de rester en sommeil pendant des milliers d’années.
La bonne nouvelle du mois : Nous en savons plus sur la vie des supercentenaires.
Maria Branyas Morera est décédée en 2024, à l’âge de 117 ans. Elle a accepté d’être déjà examinée pour étudier son état de santé exceptionnel de son vivant. Une étude publiée en février sous forme de prépublication montre qu’elle avait presque un « microbiome intestinal d’enfant ». Ses gènes l’ont protégée des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et métaboliques.
L’auteur principal de l’article, Manel Esteller, explique que cette supercentenaire suggère que, dans certaines conditions, le vieillissement et la maladie peuvent être découplés. Ceci ne concerne malheureusement qu’un petit groupe de personnes. Mais l’évolution de nos connaissances devrait permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier plus longtemps de ce découplement.
Pour plus d’informations